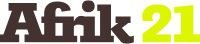La COP28 s’ouvre ce jeudi 30 novembre à Dubaï aux Émirats arabes unis (EAU). En marge de cet évènement majeur, Tosi Mpanu Mpanu, l’ambassadeur Climat de la République démocratique du Congo (RDC) accorde un long entretien à AFRIK21. Pour ce négociateur senior, la priorité du continent africain demeure l’adaptation. Sur la question du financement, il estime que les pays industrialisés doivent faire montre de leadership en matière d’action climatique.
Jean Marie Takouleu : La COP28 s’ouvre ce 30 novembre 2023 à Dubaï aux Émirats arabes unis (EAU). Les négociations commencent quelques jours seulement après l’obtention d’un compromis sur le futur Fonds pour les pertes et dommages qui sera finalement hébergé à la Banque mondiale pendant quatre ans. C’est ce que souhaitaient les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (UE). Les pays du Sud voulaient un mécanisme de financement autonome, c’est-à-dire doté de son propre système de gestion. Comment expliquer cette position du Sud ?
Tosi Mpanu Mpanu : Le Sud et les pays développés qui étaient à deux extrémités au départ, sont parvenus à se mettre d’accord sur un mécanisme pour le financement des pertes et dommages. Nous sommes partis d’un concept un peu vague au départ vers quelque chose d’un peu plus concret, même si le fond établi n’est pas totalement autonome.
Effectivement, les pays développés ont voulu héberger le fonds dans une institution existante (la Banque mondiale, Ndlr) qui a déjà une structure de fonctionnement. Le fonds a été créé à la COP27 en Égypte, avec un comité transitoire qui devait travailler pendant un an sur un instrument de gouvernance. Aux dernières heures de négociations par les membres du comité de transition, un compromis a été trouvé pour abriter le Fonds pour les pertes et dommages à la Banque mondiale pendant quatre ans. Pour nous, il s’agit d’un compromis, et non une compromission. Il fallait trouver une solution avant le début de la COP28.
La grand-messe sur le climat est donc ouverte. Au Sommet africain sur le climat (ACS), il y a quelques mois à Nairobi, les pays africains se sont mis d’accord pour parler d’une seule voix à Dubaï. Cette avancée pourrait vous aider dans les négociations à la COP28 ?
Depuis mes débuts dans les négociations à la COP13 de Bali en Indonésie en 2007, les pays africains ont toujours parlé d’une seule et même voix. À l’époque, il y avait 53 pays africains, puisque le Soudan était toujours un seul pays (avant l’indépendance du Soudan du Sud dès 2011, Ndlr). Il était important d’aller à ces négociations (avec 200 États partis), avec une position commune. Aujourd’hui, l’Afrique compte 55 pays qui parlent d’une seule voix dans l’optique de peser dans les négociations. C’est donc une voix qui peut être utilisée comme un levier pour faire avancer des positions.
En tant que négociateurs, nous nous sommes toujours engagés dans ces discussions avec une position commune. Simplement parce que nous savons qu’en allant de manière dispersée, nous avions peu de chance de faire avancer la position de l’Union africaine (UA). C’est une position commune qui ne porte préjudice à aucun des pays africains, c’est-à-dire que la position qui est adoptée pour le continent doit à la fois valoir pour l’Égypte-même si elle fait partie du Groupe des pays arabes, et pour le Cap-Vert, malgré son appartenance au groupe des petits États insulaires en développement (PIED), etc.
À Nairobi, il y a eu pour la première fois, un Sommet africain sur le climat à l’issue duquel, les dirigeants ont signé la Déclaration de Nairobi, qui pour nous, est un engagement politique, mais ne reflète pas forcement le niveau de nuance et de détail technique appliqué au niveau de la négociation elle-même.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Par exemple, nous avons dû amener beaucoup d’amendements par rapport à la position qu’avait adoptée initialement la Commission de l’Union africaine (CUA). La déclaration n’était pas mauvaise, bien au contraire. Les thématiques, notamment la sécurité alimentaire, l’énergie, le financement et la sécurité socio-économique, étaient très importantes. Mais parfois, le langage utilisé n’était pas celui des négociations proprement dites. Malheureusement, dans notre négociation, le phrasé doit rester chirurgical.
Lorsque nous allons commencer les négociations à la COP de Dubaï, nous allons travailler sur des textes qui ont un jargon particulier, avec une certaine disposition. Nous utiliserons la Déclaration de Nairobi comme boussole, sans s’y attacher mot pour mot. D’autant plus qu’elle contient certaines dispositions notamment sur les Droits de tirage spéciaux (DTS) qui sont plutôt gérés au niveau des institutions de Bretton Woods (Fonds monétaire international et Banque mondiale, Ndlr).
Quelles sont donc les priorités du continent africain à cette COP émiratie ?
L’Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre (GES). Historiquement, nous avons émis 3 % des émissions globales. Actuellement, nous sommes responsables de 4 % des émissions au niveau mondial. Malheureusement, l’Afrique est le continent le plus vulnérable face aux effets néfastes du changement climatique. Donc, la priorité du continent africain demeure l’adaptation. Parce que le changement climatique amène un surcoût en matière de développement, ce qui ralentit les perspectives de réduction de la pauvreté, et des conditions de croissance que les États essaient de mettre en œuvre.
L’Afrique subit des sécheresses, des inondations et des épidémies, à cause d’un changement climatique que nous n’avons pas créé. Certains pays ont un potentiel d’atténuation, mais pour y parvenir, il faut le financement, le renforcement des capacités, ainsi que le transfert de technologie.
Nous sommes aujourd’hui capables de mettre en œuvre une partie de nos contributions déterminées au niveau national (CDN) avec nos propres moyens. Mais l’autre partie est conditionnée par la fourniture de moyens de mise en œuvre. Sinon, il nous faudra malheureusement nous concentrer sur les priorités qui sont les nôtres, notamment le développement économique et la réduction de la pauvreté. Sinon, pour les petits États insulaires d’Afrique, la question des pertes et préjudices est également importante.
Au regard du manque de financement malgré la promesse de 100 milliards de dollars par an à la COP15 au Danemark, est-ce que les États africains ne devraient finalement pas consacrer une partie de leurs budgets nationaux à l’adaptation au changement climatique ?
Effectivement, puisqu’il y a des aléas climatiques, avant que l’aide internationale ne puisse arriver, ce sont nos ministres des Finances qui doivent réagir, avec un déséquilibre budgétaire, qu’ils n’avaient pas forcément prévu. Il nous faut être proactifs dans l’appropriation de ce sujet du changement climatique, notamment au niveau de nos législateurs, la société civile, le secteur privé, les centres d’excellence, les universités, etc.
En outre, la gouvernance internationale sur le climat qui repose sur la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée en 1992, sur le protocole de Kyoto en vigueur depuis 2005 et plus récemment sur l’Accord de Paris, tient compte de la responsabilité historique des pays industrialisés et leur demande de faire montre de leadership en matière d’action climatique et de pourvoir un appui financier. Ces financements internationaux doivent relayer les efforts nationaux des pays africains.
À la COP15 de Copenhague (au Danemark) en 2009, nous nous sommes fixé l’objectif de mobiliser 100 milliards de dollars chaque année pour les pays en développement. Le fait que cet objectif ne soit toujours pas atteint 14 ans après, pousse à se poser des questions. Pourtant, ces 100 milliards de dollars ne sont plus en adéquation avec les besoins grandissants des pays africains. Pour mettre en œuvre leurs CDN, les États du continent auront besoin de 2 800 milliards de dollars d’ici à 2030.
C’est pourquoi, il y a maintenant, une discussion assez sensible sur le Nouvel objectif collectif quantifié sur le financement de la lutte contre le changement climatique (NCQG) qui vise à adopter un nouveau chiffre d’ici à 2025. Il ne faut pas que ce soit un objectif politique, mais un objectif en adéquation avec les besoins des pays africains.
Face à ce manque de financement, les dirigeants africains cherchent des alternatives, notamment les crédits carbone. Mais la question de la taxe carbone sur les produits pétroliers prévue dans la Déclaration de Nairobi est fortement remise en cause par certaines organisations non gouvernement (ONG) qui estiment que ce sera une planche de salut pour les gros pollueurs. Quel est votre avis sur cette question ?
Il faut savoir raison garder. J’aime beaucoup les ONG parce qu’elles font beaucoup de recherches et fournissent des rapports qui sont très utiles. Mais, il faut regarder les choses de manière objective. Nous pouvons aller vers une transition écologique et énergétique pour une neutralité carbone d’ici à 2050 et limiter la hausse des températures à 1,5° ou 2 °C. Nous constatons malheureusement que les pays producteurs de pétrole continuent à augmenter leurs productions, non pas parce qu’ils veulent polluer la planète, mais pour répondre à la demande.
Donc, si nous voulons vraiment sauver la planète, changeons nos modes de consommation, et cela créera une baisse de la demande en produits pétroliers et les producteurs ne voudront pas travailler à perte. Il faut créer une incitation pour que les producteurs puissent mettre les mains dans la poche. Cependant, la pression fiscale ne doit pas être punitive, mais plutôt incitative.
Il sera beaucoup question de la transition énergétique à la COP28. Justement, les chefs d’États et de gouvernements africains veulent porter la capacité de production d’énergies renouvelables de 56 GW en 2022 à au moins 300 GW d’ici à 2030. Pourtant, le continent ne reçoit que 3 % des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. Est-ce un objectif réaliste ?
Il ne s’agit pas de réalisme, mais de nécessité, parce qu’il y a 600 millions d’Africains qui vivent encore sans électricité. Dans le même temps, au moins 900 millions de personnes cuisinent avec du charbon de bois, ce qui les expose aux maladies respiratoires. Un meilleur accès à l’énergie pourrait créer des moyens productifs, notamment l’irrigation, avec de meilleurs rendements agricoles. Il permettrait également un meilleur accès à l’éducation pour nos jeunes filles qui auront la possibilité d’aller au champ en journée et d’étudier le soir.
Tout cela est possible aujourd’hui, grâce notamment à la baisse du coût de certaines technologies. Avant, il y avait une grande source de production d’électricité, associée au transport sur de longues distances, avec des déperditions, et un coût énorme pour l’installation des infrastructures de transmission. Aujourd’hui, il y a des systèmes décentralisés et hors réseau, qui apportent de l’électricité directement là où se situe la demande. Ce sont des systèmes disparates qui pourraient, avec le temps, s’interconnecter entre eux.
Il est absolument nécessaire d’accompagner cette volonté par une libéralisation du secteur de l’électricité afin de permettre aux acteurs privés d’investir dans ces nouvelles solutions. Il faudra également mettre en place des facilités ou des fonds de garantie pour faciliter l’entrepreneuriat pour que le secteur des énergies renouvelables puisse vraiment se développer. L’objectif de 300 GW d’ici à 2030 n’incombe pas seulement aux États et aux grandes entreprises. Il nécessite une véritable décentralisation afin de produire tous les jours, au moins 1 MW additionnel.
Dans sa contribution déterminée au niveau national (CDN) actualisée, la RDC s’engage à atteindre un objectif de réduction d’émissions de 21 % en 2030, dont 19 % sous condition de soutien. Dans le même temps, votre pays veut se lancer dans production des énergies fossiles (pétrole et gaz). N’y a-t-il pas contradiction ?
Un appel d’offres a été lancé pour 27 blocs pétroliers et trois blocs gaziers. Mais la production proprement dite n’a pas encore commencé. La RDC est un pays extrêmement pauvre, avec 80 % de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Le pays ne peut pas se priver de tous les leviers possibles pour générer des revenus. Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur le volet minier, et la RDC en toute souveraineté a le droit d’explorer toutes les potentialités au niveau pétrolier.
Il faut arrêter cette hypocrisie, car, si la RDC venait à produire son pétrole, cette énergie serait consommée à l’extérieur. Les pays qui nous pointent du doigt en disant que nous sommes les mauvais élèves en matière climatique doivent diminuer leurs demandes de pétrole. Si des pays comme les États-Unis d’Amérique, la Norvège, la France, la Russie, l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis (EAU), continuent à augmenter leur production, pourquoi pas la RDC ?
Paradoxalement, la RDC qui dispose de faibles revenus, n’arrive pas à gérer comme il se doit, certains aspects de sa politique environnementale. Nous sommes en train de perdre le combat pour la conservation de la forêt, parce que nous n’avons suffisamment pas de ressources. Il y a une espèce de colonialisme environnemental, qui veut que, pour préserver notre forêt, nous devions tendre les mains vers les bailleurs de fonds internationaux. Pourtant, en produisant du pétrole, nous pourrons avoir plus de ressources et en allouer une partie à la préservation de l’environnement.
Par ailleurs, avec les moyens modernes, on peut réduire l’impact environnemental de l’extraction du pétrole, notamment en captant le gaz qui est souvent torché. Objectivement, tous les minerais stratégiques pour la fabrication des batteries de voitures électriques et autres systèmes de stockages pour les centrales solaires viennent de la RDC. Donc, nous participons de manière excédentaire, à la décarbonation de l’économie mondiale.
Quid des gisements situés dans les aires protégées ?
Il y a également un moyen d’atteindre, avec une exploitation en oblique, une zone protégée sans pouvoir y pénétrer. En outre, la RDC est prête à ne pas exploiter cette ressource, si et seulement si nous avons une juste compensation.
Des propos recueillis par Jean Marie Takouleu