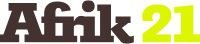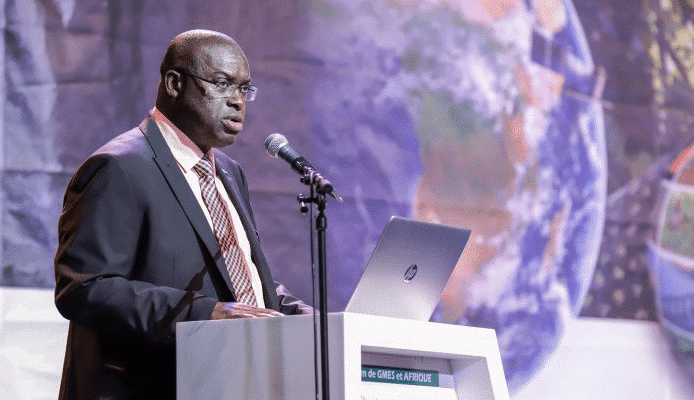Kenya, Afrique du Sud, Égypte, Algérie, Nigeria, Maroc, Éthiopie… ces pays africains ont mis plusieurs satellites en orbite terrestre ces dernières années. Pour Tidiane Ouattara, le spatial devrait davantage se développer sur le continent au cours des prochaines années. Dans cet entretien réalisé en marge du premier Forum GMES & Africa Phase 2, l’expert en sciences spatiales à la Commission de l’Union africaine (CUA) revient sur les objectifs du programme Global Monitoring for Environment and Security and Africa (GMES & Africa) qu’il coordonne. Cette initiative permet notamment de mieux répondre à l’urgence climatique en Afrique.
AFRIK 21 : Quels sont les objectifs du programme GMES & Africa ? Comment contribue-t-il à la gestion de l’environnement et à la sécurité en Afrique ?
Tidiane Ouattara : GMES & Africa est un programme de plusieurs années basé sur la stratégie à long terme entre l’Afrique et l’Europe, dans le cadre de l’Agenda 2063 qui est la boussole de l’Union africaine (UA). Sur la base de cette stratégie de coopération entre les deux continents, dans le volet « science technologie et innovation », l’Afrique a demandé l’appui de l’Europe dans le cadre de la science et la technologie spatiale.
L’objectif était de travailler sur l’environnement, booster l’économie et renforcer les capacités africaines. Dans le cadre du programme, le satellite Copernicus de l’Agence spatiale européenne (ESA) est utilisé pour cartographier les ressources naturelles, l’eau, ainsi que les zones côtières et marines. L’idée est que les experts africains puissent s’appuyer sur les sciences et technologies spatiales pour la gestion des ressources naturelles, notamment l’occupation des sols, la gestion des ressources marines, mais également des inondations.
Le renforcement des capacités concerne les ressources humaines, et surtout les infrastructures de réception de données sur le continent.
Concrètement, comment le programme GMES & Africa aide un pays comme le Kenya à faire face à la sécheresse ?
Nous n’avons pas pour rôle de mettre en œuvre des projets sur le terrain. Cette tâche incombe aux institutions nationales et sous-régionales avec qui nous travaillons. C’est le cas du Centre de prévision et d’applications climatiques de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) dont fait partie le Kenya. Sur la question de la sécheresse, ce centre s’occupe de plusieurs autres pays en Afrique de l’Est. Grâce au programme GMES & Africa, le centre a élaboré des cartes beaucoup plus fines, avec des données actualisées, en misant notamment sur la carte d’occupation du sol. Les terres dégradées et humides ont également été cartographiées. Donc, nous les soutenons avec des informations fiables, à grande ou à petite échelle.
En tant que spécialiste de la télédétection, quelle est votre vision de l’utilité du programme pour le développement de l’économie et du secteur privé ?
L’Afrique est un grand continent (30 millions de km2) avec une population en pleine croissance de 1,3 milliard d’habitants et doté d’énormes ressources naturelles. C’est extrêmement difficile de gérer tout cela avec les méthodes traditionnelles. Avec l’espace, nous avons l’opportunité de mieux gérer nos ressources puisqu’il fournit des informations capables de se répéter en un temps très court, à grande et à petite échelle. Concrètement, vous avez la possibilité d’avoir des informations sur le village tout comme vous pouvez en avoir à l’échelle d’un pays à partir d’un seul satellite.
Donc, pour moi, l’utilisation de l’espace en Afrique est primordiale et incontournable. Nous voulons prendre avantage des sciences spatiales pour renforcer les capacités des jeunes et des décideurs sur la nécessité de développer des scénarios avant les prises de décisions. Par exemple, grâce à l’espace, on peut faire des prévisions concernant la sécheresse sur 30 ans.
Sur l’économie, l’espace augmente la productivité. Par exemple, le consortium de GMS au Ghana a développé un service qui s’appuie sur le téléphone portable pour améliorer la pratique de la pêche sur les côtes ghanéennes. Ce système agit également sur les méthodes en identifiants des zones de pêche. Cela engendre des économies d’énergies.
Quel rôle avez-vous joué dans l’adoption de la politique spatiale et la création de l’Agence spéciale africaine (ASAf) ?
Je suis arrivé après l’adoption de la politique spatiale de l’UA. J’avais donc la responsabilité de la mettre en œuvre cette politique à travers trois volets : la création d’une gouvernance, la mise en place des programmes d’action, ainsi que la promotion et l’éveil des consciences sur la question du spatial.
C’est donc grâce au volet gouvernance que nous avons pu mettre en place l’ASAf. Sur le côté programmatique, nous avons la responsabilité de mettre en œuvre le programme GMES & Africa avec l’appui du secteur privé. Dans ce cadre, nous avons déjà installé 12 stations de réceptions de données satellitaires dans 11 pays, dont la plupart sont situés en Afrique du Nord, puisque l’Afrique subsaharienne était déjà plus ou moins un peu ravitaillée. Avec nos partenaires, l’Agence spatiale européenne (ISA), le Centre commun de recherche (CCR), la Commission européenne, nous travaillons en synergie avec les Africains dans le cadre de la mise en œuvre de GMES & Africa.
À cette étape du programme, quel bilan pouvez-vous en tirer ?
Grâce à GMES & Africa, nous avons pu montrer l’utilité de l’espace de façon concrète à tous les pays membres de l’UA. En outre, au moins 10 000 jeunes ont été formés sur tout le continent, avec le concours de 120 institutions de 45. Sinon, ce que nous considérons à l’UA comme le plus grand résultat politique qui répond à l’Agence 2063, c’est la mobilisation, pour la première fois, de ces institutions pour travailler d’un commun accord sur un programme continental. Nous avons également lancé l’initiative Women in GMES afin de permettre aux femmes de prendre pleinement part à tout ce qui est spatial en Afrique.
Le premier forum GMES & Africa Phase 2 se tient du 27 au 30 novembre 2023 à Sharm El Sheikh en Égypte. Quels sont les objectifs avec l’organisation de ce forum ?
Le forum est organisé deux fois durant le programme GMES & Africa, c’est-à-dire au milieu et la fin de chaque phase (4 ans). C’est une plateforme que nous donnons à tous les intervenants, notamment les utilisateurs de service pour réfléchir sur le futur du programme. L’évènement accueille également les décideurs et les acteurs du secteur privé. Il y a par exemple des panels de haut niveau avec des professionnels de plusieurs secteurs, pour partager leurs visions du spatial en Afrique.
Il y a également des consortiums qui vont partager leurs réalisations et les défis auxquels ils sont confrontés. Ce forum est la plateforme de réseautage qui vise à mobiliser les idées. C’est une façon pour nous d’inviter les Africains à considérer leur appartenance à un seul continent pour pouvoir livrer ses enjeux.
Quel est votre rôle dans l’initiative Digital Earth Africa et son importance pour le continent africain ?
C’est une initiative australienne soutenue par Amazon, visant à réunir les données disponibles sur le continent africain et à les mettre sur une base de données. Comme en Australie, le but est de faciliter l’accès à ces données. Dans ce cadre, l’Union africaine a été sollicitée pour faire partir du Conseil d’administration où je siège. Le programme GMES & Africa ne répondra pas seul aux préoccupations des Africains sur les données générées à travers l’espace. Le Digital Earth Africa est hébergé au sein de l’Agence spatiale nationale sud-africaine (Sansa) avec des bureaux satellites à Nairobi au Kenya, et bientôt à Accra au Ghana.
Outre l’Australie, êtes-vous en relation avec d’autres grandes puissances sur le spatial ? Est-ce que le secteur privé africain s’intéresse déjà à la question comme c’est le cas aux États-Unis d’Amérique avec le milliardaire Elon Musk qui y a beaucoup investi ces dernières années ?
De par sa nature, personne ne peut se lancer seul dans le spatial, puisque c’est un domaine vaste et complexe, avec de multiples enjeux. L’Afrique, arrivée récemment dans le spatial, ne peut pas refaire les mêmes erreurs qu’elle a commises dans d’autres domaines par le passé. Les histoires à succès des autres doivent nous inspirer. Comme vous le savez, l’Afrique est ouverte à tout le monde, mais c’est à elle seule de déterminer ses besoins.
Dans ce cadre, il faut absolument développer les capacités locales. La contribution des investisseurs privés sera déterminante pour atteindre nos objectifs. Au niveau africain, le secteur privé est en pleine naissance dans le secteur spatial. Il aura besoin d’être structuré, et il faudra mettre en place des écosystèmes pour favoriser la croissance de ces entreprises.
En tant qu’expert du spatial, quelles doivent les priorités des pays africains sur cette question ?
Les pays sont souverains. Le Cameroun est par exemple en train de lancer sa propre agence spatiale. Notre rôle est de conseiller les pays. Il est donc difficile de parler de priorité puisque l’espace est transversal et doit répondre aux préoccupations de chaque pays. Seulement, cette priorité doit être inscrite dans l’Agence 2063 de l’Union africaine.
En parlant du Cameroun, le ministère des Postes et Télécommunications a annoncé il y a quelques mois, son intention de mettre un satellite en orbite. Cela a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Les Camerounais recommandent au gouvernement de se pencher d’abord sur les services essentiels, notamment l’eau et l’électricité. Est-ce que vous comprenez ces critiques ?
Il y a eu le même tôlé en Côte d’Ivoire, lorsque le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé il y a 2 ans, la création d’une agence spéciale nationale. Je pense qu’il y a une éducation à faire. Avant de faire une telle annonce, il faut prendre le temps de préparer nos différentes audiences. Car, l’interaction sur les réseaux sociaux est aujourd’hui possible grâce à la science spatiale. Le coût élevé de la télécommunication est en partie lié à la location des satellites. Et donc, si votre pays dispose d’un satellite de télécommunication, il y aura forcément un impact sur le coût final. Les populations sont moins surprises si elles sont préparées.
Des propos recueillis par Delphine Chêne et Jean Marie Takouleu